Petit troupeau, point d’appui pour le salut de tous
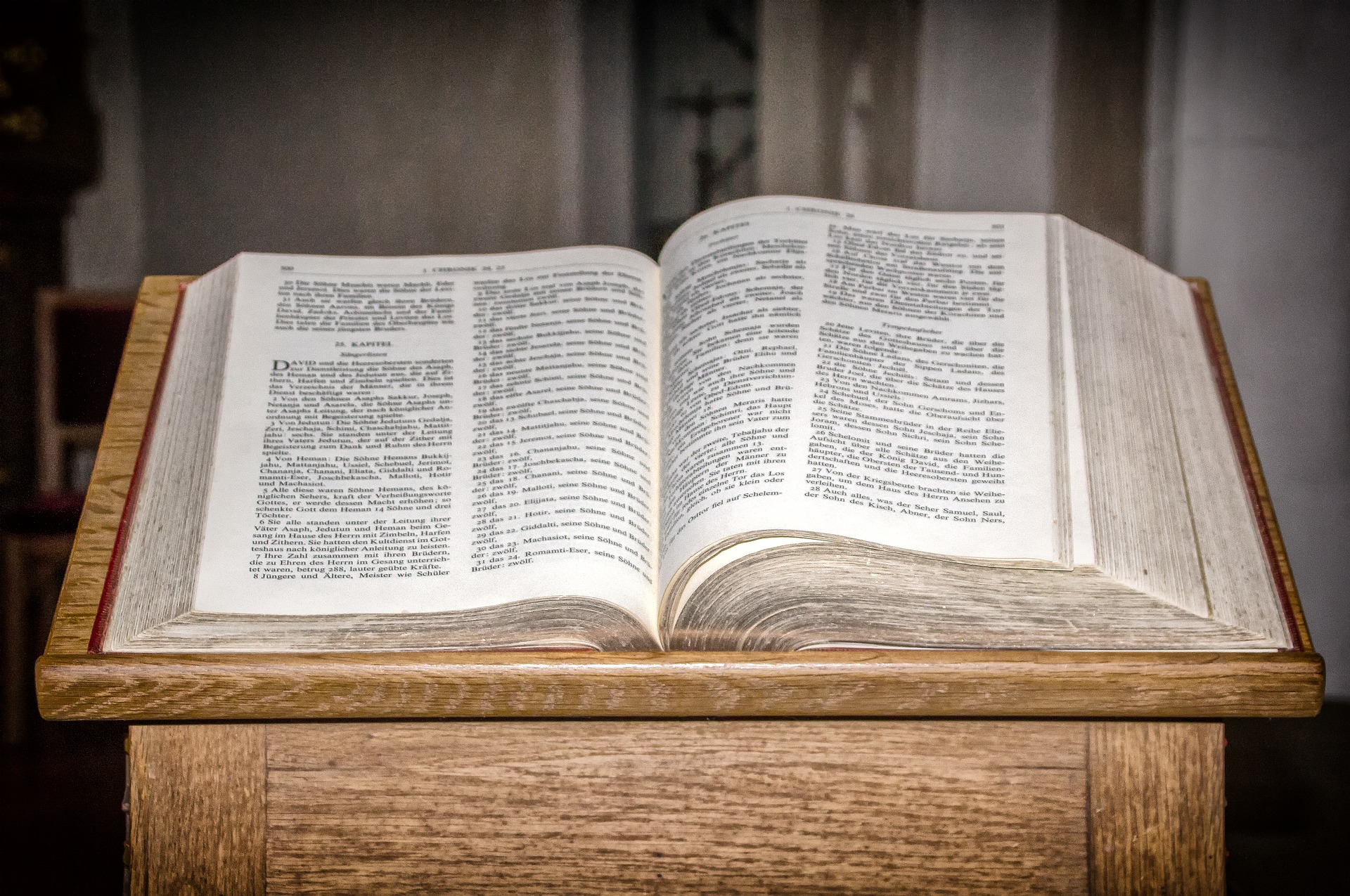
Petit troupeau, point d’appui pour le salut de tous
L’Évangile de dimanche dernier s’ouvrait avec cette exhortation du Seigneur Jésus : « Sois sans crainte, petit troupeau… » Prêter l’oreille à la voix du Seigneur et le suivre résolument a été et sera toujours le fait du petit nombre, quoi qu’en disent les statistiques officielles. Sur les dizaines de millions de Français baptisés, combien sont-ils à écouter et suivre le Seigneur ?
Rien de nouveau sous le soleil en réalité. À Jérusalem au temps du prophète Jérémie, tous ou presque appartenaient au peuple de l’Alliance, et pourtant le prophète s’est retrouvé seul contre tous lorsqu’il lui a fallu annoncer la parole reçue du Seigneur. Le seul à se ranger de son côté fut finalement Ébed-Mélek l’Éthiopien, qui d’ailleurs n’était même pas juif.
Le Seigneur Jésus, vraie Lumière, est venu éclairer tout homme (cf. Jn 1,9). Partout où il passait, il faisait le bien (cf. Ac 10,38). Parfaitement ajusté à la volonté du Père, il a cependant connu la contradiction, jusqu’à la honte du supplice de la croix. La lecture de la lettre aux Hébreux nous en avertit : telle fut la condition du Maître, telle sera celle des disciples. Il est absolument normal que, dans notre entourage, nous expérimentions incompréhensions, contradictions et même conflits au sujet du Seigneur Jésus, que nous nous sentions petit troupeau au milieu des loups.
Les lectures de ce dimanche m’ont rappelé un texte de J. Ratzinger. Le futur pape Benoît XVI écrivait que le Seigneur Jésus, en instituant l’Église, a par conséquent institué également la non-Eglise, divisant l’humanité en deux ensembles inégaux. Puisqu’il y a désormais la communion des frères et sœurs unis par la foi au Dieu trinitaire, qui adorent ensemble le Père, par le Fils dans l’Esprit, il y a aussi la multitude de ceux qui, bien que différents, ont en commun de n’être pas d’Eglise.
Or l’Église a toujours été et sera toujours petit troupeau face à la multitude. L’Évangile l’annonce clairement, et l’histoire l’illustre. C’est évident en ce qui concerne les chrétiens vivant dans les sociétés majoritairement islamiques, confucéennes ou animistes. Cela le devient de plus en plus dans notre société néo-païenne. Et cela vaut même pour les sociétés dites chrétiennes, où prendre au sérieux l’Évangile restait le fait du petit nombre.
L’histoire de Jérémie et de Jésus se rejoue partout et tout le temps, dans notre entourage, dans nos familles, et peut-être même dans notre propre cœur, où nous découvrons parfois une forte résistance à l’Évangile.
Que faire de cela ? Devant la non-Eglise, l’Église a pu faire le choix du sectarisme : se retrancher des autres pour se protéger. Elle a parfois aussi choisi l’universalisme, tout aussi délétère. L’universalisme ne tient pas compte de l’identité de l’autre ; il cherche à mettre la main sur l’autre, lui disant : « Au fond, tu es un brave type, donc tu es chrétien comme moi, que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non. » En résumé, le sectarisme rejette l’autre loin de l’Église et l’universalisme l’assimile à l’Église, mais c’est toujours l’Église qui est au centre.
Il existe une troisième voie, lorsque l’Église se souvient que, depuis la Pentecôte, elle est et reste catholique, c’est-à-dire « pour la totalité ». En effet, Jésus de Nazareth, cet homme singulier, unique, incomparable, est aussi par excellence l’homme pour les autres, le seul qui puisse dire en toute vérité : « Le Fils de l’homme [est venu pour] donner sa vie en rançon pour la multitude. » (Mt 20,28), « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. » (Mc 14,24)
Pour nous chrétiens, le Seigneur Jésus est plus qu’un bel exemple du passé. Il vit en nous et nous vivons en lui. L’Église que nous sommes est la présence vivante et agissante du Christ Jésus. Comme lui, elle est pour la multitude. J. Ratzinger écrit : « Le petit nombre est le point d’appui au moyen duquel Dieu veut sauver la multitude. » Cette règle vaut pour l’humanité dans son ensemble, comme aussi pour nos cercles professionnels, amicaux et familiaux.
L’Église existe pour les autres. Lorsqu’elle penche vers le sectarisme qui rejette l’autre ou lorsqu’elle opte pour l’universalisme qui le dissout, elle cesse alors d’être l’Église. Le Concile Vatican II a écrit que l’Église est par nature missionnaire et le pape S. Paul VI qu’elle existe pour évangéliser. Et cela vaut aussi bien pour le monde que pour notre famille.
J. Ratzinger distingue trois services que le petit troupeau de l’Église a à apporter à la multitude. Le premier est l’annonce explicite du Christ, de façon à ce que tous puissent entendre la parole du salut et de la réconciliation. Le deuxième est le témoignage de la charité sincère et désintéressée ; celle que les frères et sœurs dans le Christ se témoignent les uns aux autres, et celle qu’ils exercent au nom du Christ en faveur du prochain que le Seigneur met sur leur chemin.
Le troisième service est celui que J. Ratzinger développe le plus longuement, et celui qui consonne le plus avec les lectures de ce dimanche, peut-être aussi avec notre expérience. Comme l’ont fait Jérémie et tous les prophètes, les Apôtres et les innombrables témoins du Christ, comme l’a fait le Seigneur Jésus lui-même, nous pouvons souffrir par les autres et pour les autres, sûrs que cela porte mystérieusement du fruit. En voici trois illustrations historiques.
Il y a 1700 ans, après le concile de Nicée, la multitude des chrétiens, en particulier les pasteurs, refusait la divinité de Jésus. Seuls quelques évêques courageux, saint Athanase et saint Hilaire notamment, ont tenu bon dans les vexations et l’exil, jusqu’à ce que resplendisse la vérité.
L’Évangile était entré en Corée au XVIIIe siècle. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les chrétiens coréens ont subi brimades et persécutions. Plus de 10 000 martyrs, une multitude de confesseurs de la foi ; aujourd’hui, on prépare les JMJ de Séoul dans un pays qui est un poumon de l’Église mondiale.
Au début du XXe siècle, des théologiens, majoritairement français, ont souffert par l’Église en raison de leurs idées jugées trop novatrices. Cinquante ans plus tard, réhabilités, ils furent les inspirateurs du Concile Vatican II.
Comme Jérémie et les innombrables témoins de la foi, il arrive que nous ne puissions plus parler du Seigneur autour de nous, ni même faire du bien aux autres en son nom. Il nous reste alors à entrer dans le mystère de la croix.
La croix est le mystère de l’épreuve féconde, du salut qui passe par la souffrance acceptée par amour. Devant le mystère de la croix, on ne peut que garder le silence. Même le Seigneur Jésus n’a pas prétendu l’expliquer. Il n’a pas anticipé la passion. Il a seulement accepté les conséquences de l’amour jusqu’au bout, jusqu’à la croix, sûr que cela apporterait enfin ce feu qu’il était venu allumer, ce baptême dans la mort et la résurrection qu’il était venu instituer ; il savait que la passion et la croix vécue par amour, même par un seul, même par un petit troupeau, seraient le salut de la multitude.
Père Alexandre-Marie Valder