Au commencement était la joie
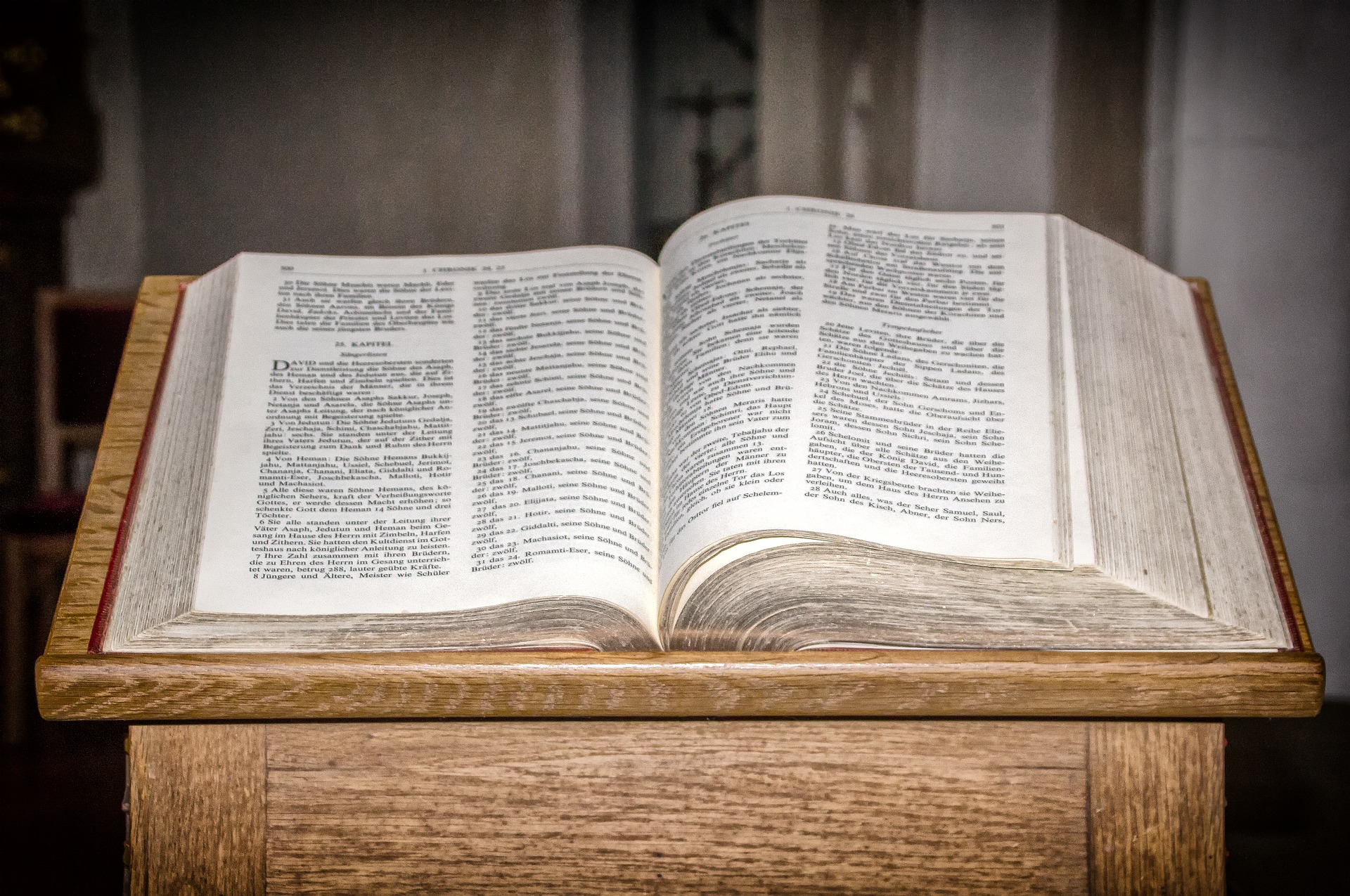
Au commencement était la joie
À la lumière des textes de ce dimanche, il nous faut aborder un sujet grave : la joie. Il en est question dès la première lecture.
Le livre de la Sagesse est le livre le plus récent de notre Ancien Testament, écrit en grec quelques décennies à peine avant le Christ. La lecture de ce dimanche est extraite d’une longue méditation des événements de la libération d’Egypte, qui culmine avec la nuit de la première Pâque : « La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ; assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. » En poursuivant un peu le texte, nous lisons : « déjà ils entonnaient les chants de louange des Pères. » Quant au psaume choisi pour répondre à cette lecture, il nous a fait chanter : « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ! »
L’eucharistie que nous célébrons nous entraîne dans le mystère pascal du Christ. Par lui, avec lui et en lui, aujourd’hui nous passons à travers la vie et la mort, de ce monde au Père. Il est fondamental de s’y préparer par deux attitudes : la pénitence et la joie.
En ce qui concerne la pénitence, cela semble naturel. À quoi bon s’approcher du Seigneur si l’on n’a pas conscience de son besoin d’être libéré, guéri et pardonné, et si l’on n’a pas le désir de faire son possible pour être toujours plus ajusté au Seigneur ? Au début de chaque eucharistie, nous reconnaissons que nous avons péché, nous demandons la prière de nos frères et sœurs et le pardon du Seigneur.
Que cela ne nous fasse pas oublier la joie, qui est une attitude plus fondamentale encore que la pénitence. Le projet de bonheur du Seigneur pour son peuple remonte à l’origine. Le Seigneur notre Dieu a créé l’homme et la femme pour la joie. Avant le péché pour lequel nous faisons pénitence, il y a la promesse de joie à laquelle rien ne pourra faire obstacle. Au commencement était la joie.
À Abraham a été faite la promesse d’une vie à laquelle même la mort ne peut faire obstacle, et c’est pourquoi il a osé aller jusqu’au bout de la confiance : « Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration. »
Nous sommes tous dans la situation d’Abraham, nous à qui est adressée la promesse de l’Évangile : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. » Voilà ce qui doit résonner en nous chaque jour, et spécialement le dimanche lorsque nous préparons nos cœurs à l’eucharistie : notre Père a trouvé bon de nous donner le Royaume ; nous venons le recevoir.
« Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. » Le Royaume nous est donné pourvu que nous voulions bien l’accueillir en suivant le Seigneur Jésus jusqu’à la croix et au-delà, en veillant dans la foi y compris lorsque la nuit se fait longue, toujours soutenus par la joie qui naît de l’espérance, l’attente confiante de la réalisation des promesses du Père. « Heureux – encore la joie ! – ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. »
Au commencement était la joie. À la naissance du Seigneur Jésus, les anges annoncèrent aux bergers « une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple ». Lorsque les mages venus d’Orient virent l’étoile s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant, « ils se réjouirent d’une très grande joie ». Plus tard, c’est encore par la joie que le Seigneur a inauguré son enseignement : « Heureux les pauvres de cœur… heureux ceux qui pleurent… heureux les doux… »
La joie éclata au moment de la résurrection, lorsque les femmes « quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et coururent porter la nouvelle » et lorsque « les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur ». La joie continue de résonner au long des évangiles et des épîtres, jusqu’au livre de l’Apocalypse, que nous citons à chaque eucharistie : « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! »
Pour mieux comprendre cette invocation, revenons une dernière fois au livre de la Sagesse : « Dans le secret de leurs maisons, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d’un commun accord cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de louange des Pères. »
Les esclaves ont mangé la chair de l’agneau sacrifié dont le sang marquait leurs portes en vue de la délivrance. En communiant autour du même repas, ils consacraient la solidarité du peuple dans les épreuves et dans la joie. Plus profondément encore, ils disaient la mystérieuse solidarité du Seigneur Dieu avec son peuple, le peuple avec lequel il allait parler et marcher au désert, au milieu duquel il allait planter sa tente. « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. » Les saints, y compris le Seul Saint, le Seigneur, partageraient aussi bien le meilleur que le pire.
Ce mystère de la solidarité divine et humaine culmine dans l’incarnation. Le Verbe s’est fait chair. Il a habité parmi nous. Il a partagé le repas avec les pécheurs. Dans sa passion, il s’est même fait solidaire des souffrants et des abandonnés. Il est entré dans la mort seul, comme nous le ferons tous, afin que désormais plus personne ne soit seul dans la mort. L’Agneau innocent porte et enlève les péchés du monde ; il jette au loin tout ce qui nous sépare du Père, afin que nous soyons libres d’entrer dans le Royaume, afin que nous puissions recevoir la joie préparée pour nous depuis la fondation du monde.
Père Alexandre-Marie Valder