« Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple »
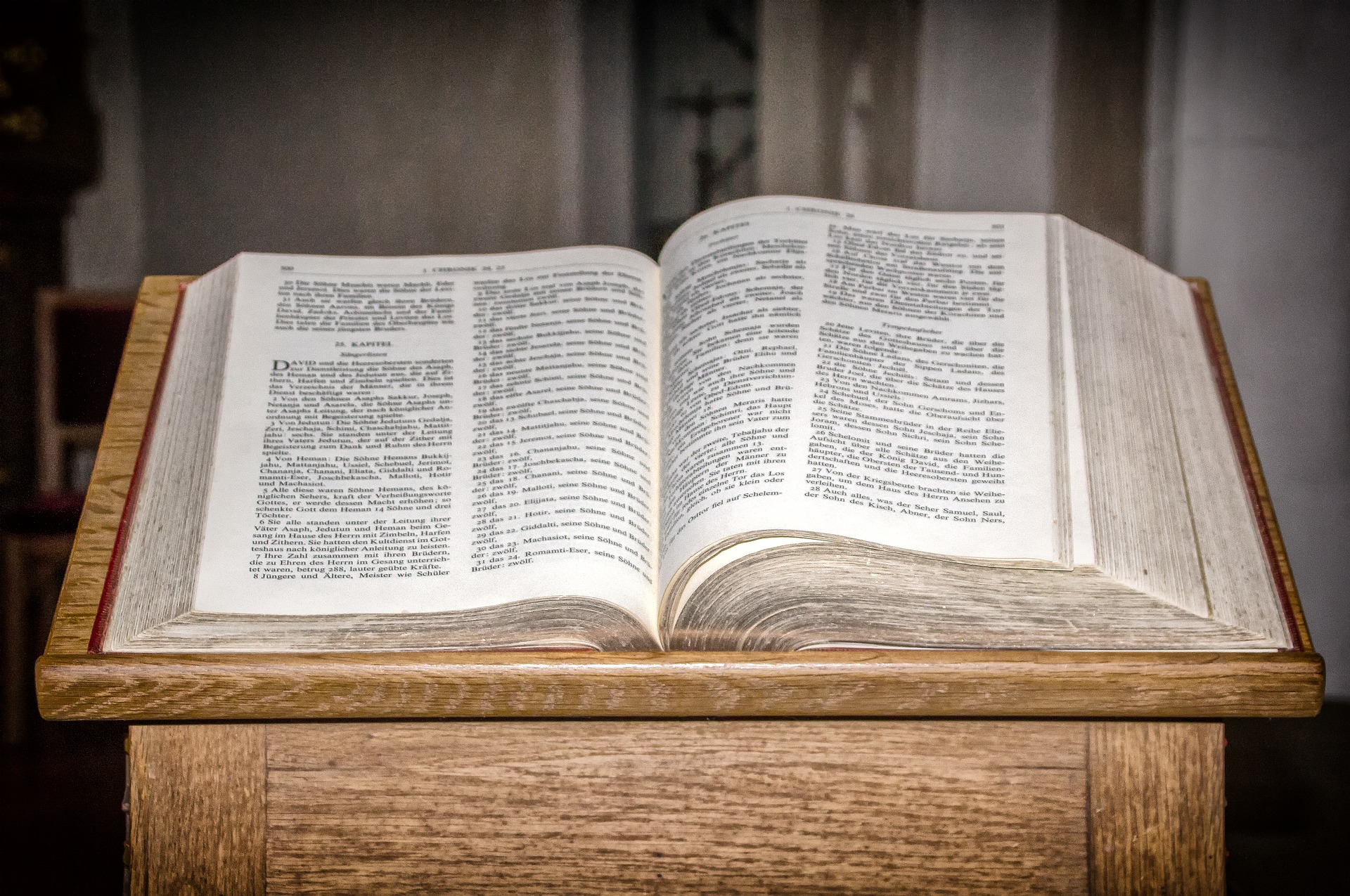
« Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple »
« Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’année de la mort du roi Ozias, le prophète Isaïe est mis en présence de la gloire du Seigneur. Il voit le Seigneur siégeant en majesté et il entend les séraphins ; il ressent le tremblement des portes et il est environné de fumée.
Pour une part, la crainte qui le saisit est une sorte de peur primaire devant ces manifestations extraordinaires. Pour une autre part, elle est un vertige légitime face à la transcendance de Dieu, lui qui est toujours au-delà : au-delà de nos mots, de nos représentations, de l’idée que nous nous faisons de lui.
La Bible a un mot pour exprimer ce qu’est Dieu : Dieu est « saint ». « Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers », crient les séraphins. À chaque eucharistie, nous faisons nôtre ce cri des séraphins. Dieu est le Saint, le Tout-autre, celui qu’un abîme infini sépare de l’être humain. Il est impossible et inconcevable qu’une créature se trouve en présence du Dieu trois fois saint. C’est pourtant ce qui arrive à Isaïe, d’où le vertige qui s’empare de lui.
Des siècles après Isaïe, Pierre fait cette même expérience devant Jésus. Pas de trône élevé, pas de fumée, pas de séraphins, pas de tremblement de terre, mais le même vertige, la même révérence : le Seigneur s’est fait reconnaître à travers le signe de la pêche miraculeuse. Il est là présent. Quelque temps plus tôt, Jean le Baptiste avait été saisi de la même crainte : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! »
N’oublions pas Paul qui écrit : « Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. » Suivant la pure logique humaine, Paul n’aurait jamais dû bénéficier de la manifestation glorieuse et du pardon du Seigneur qu’il avait persécuté. C’est impossible, inconcevable, et pourtant c’est arrivé.
Rassemblés aujourd’hui pour célébrer la messe, rappelons-nous que personne n’a gagné sa place à ce repas du Seigneur.
Gratuitement, gracieusement, le Seigneur nous invite et nous rassemble ; il nous fait le don de ce moment de qualité avec lui et en Église, le don d’un temps qui ne sert à rien, ne produit rien, ne rapporte rien, et qui ainsi nous rappelle que nous ne sommes pas sur terre pour être rentables.
Gratuitement, gracieusement, le Seigneur nous adresse la parole, une parole qui tantôt nous console, tantôt nous secoue, tantôt nous éclaire ; en retour, le Seigneur nous écoute lorsque nous lui présentons nos demandes pour nous-mêmes et pour le monde.
Gratuitement, gracieusement, le Seigneur se rend présent à nous et nous livre sa vie ; il nous entraîne dans sa Pâque, nous fait passer par sa mort et sa résurrection ; il nous redit que même la mort ne peut éteindre l’amour qu’il a pour chacun, que même blessé et tué, il ne cesse jamais de nous aimer.
Gratuitement, gracieusement, le Seigneur nous accorde sa confiance, il nous bénit, nous missionne et nous envoie.
C’est impossible, inconcevable ; cela arrive chaque jour depuis 2000 ans.
Aucun de nous n’a mérité l’amour du Seigneur. En première analyse, nous pouvons être attristés de commencer chacune de nos messes en reconnaissant que nous avons péché et en demandant la prière de la Vierge Marie, de tous les saints et de nos frères et sœurs ; de redire à chaque messe les mots du centurion de Capharnaüm à Jésus : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir… »
Je crois pouvoir montrer que ces paroles doivent en réalité nourrir en nous la joie ; la joie d’être aimés gratuitement et gracieusement, envers et contre tout. Personne n’a gagné sa place à ce repas du Seigneur. Personne ne peut donc perdre sa place à la suite d’un revers de fortune ou d’un caprice du Seigneur. Ce qui peut arriver, c’est seulement de refuser de venir prendre la place que le Seigneur offre gratuitement, gracieusement, sans mérite de notre part.
Reconnaître que je ne suis pas digne de recevoir le Seigneur, c’est reconnaître avant tout que le Seigneur est celui qui se donne à recevoir. Reçu ou non, le Seigneur se donne inlassablement, gratuitement, gracieusement. J’aime citer les paroles du pape Benoît XVI à l’inauguration de son pontificat :
« En quelque sorte, n’avons-nous pas tous peur – si nous laissons entrer le Christ totalement en nous, si nous nous ouvrons totalement à lui – peur qu’il puisse nous déposséder d’une part de notre vie ? […] Non ! Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien – absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. […] Ainsi, aujourd’hui, je voudrais, avec une grande force et une grande conviction, à partir d’une longue expérience de vie personnelle, vous dire […] : n’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. »
Frères et sœurs, ne craignons pas la crainte, la crainte de Dieu authentique, saine et sainte, qu’on ressentie Isaïe, Pierre et les autres, cette crainte qui n’est ni la peur de Dieu, ni le désarroi devant les mots et les gestes de la liturgie. La crainte authentique nous empêche d’être des gens habitués, blasés, et par conséquent imperméables à celui qui se donne à nous.
Avec le pape François, qualifions cette attitude d’« émerveillement » ; émerveillement devant le fait que le dessein de salut de Dieu nous est révélé et nous touche ici et maintenant grâce à la liturgie. Comme le chante un psaume : « Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple ».
Père Alexandre-Marie Valder